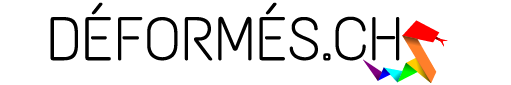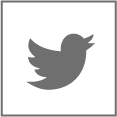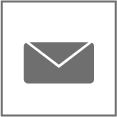«Il faut apprendre à nommer ce qui fait peur»
La chercheuse et docteure ensciences de l’éducation Christine Fawer Caputo a su imposer une approche novatrice qui ne se limite pas à l’accompagnementdu deuil. Professeure associéeà la Haute école pédagogique du cantonde Vaud (HEP Vaud), elle a coédité plusieurspublications de référence en la matière, dont certaines sont disponibles au centre qu’elle coordonne à la HEP Vaud. Conçues pour guider les enseignants et les professionnels confrontés à ces thématiquessensibles, ces ressources participent à une reconnaissance progressive du sujet dans le champ éducatif.
A côté de ses recherches, elle développe et anime des modules de formation consacrés à la perte et au deuil. Ces cours, bien que très sollicités, demeurent facultatifs – un choix assumédestiné à préserver la sensibilité et le parcours personnel des futurs enseignants, parfois eux-mêmes marqués pardes expériences de deuil.
Pour Christine Fawer Caputo, seule une démarche volontaire, encadrée et empreinte d’empathie permet de faire émerger une parole juste sur ces questions. Car aborder la mort avec des enfantsne signifie ni les alarmer ni les accabler. L’enjeu, rappelle-t-elle, est de leur offrir des repères adaptés à leur âge, à leur compréhension et à leur vécu.
Chez les plus jeunes, l’usage d’euphémismes tels que «papa est parti envoyage» peut susciter des malentendus durables. Mieux vaut parler simplement,sans esquiver ce que l’on ignore: «Onpeut aussi dire que l’on ne sait pas, mais que l’on peut réfléchir ensemble», insiste la chercheuse
Cette honnêteté pédagogique s’inscrit dans une réflexion plus large, où la mort n’est qu’une des nombreuses formes de perte que vivent les enfants: disparitiond’un proche, déménagement, séparation parentale, rupture amicaleou amoureuse… «Autant de petites ou grandes fractures qu’il est nécessaire d’apprendre à nommer et à traverser, car elles font partie de la vie.»
Le vrai blocage est celui des adultes
Le véritable blocage, selon elle, ne vient pas des enfants, mais des adultes. Parents comme enseignants craignent d’en dire trop ou de mal s’exprimer, et préfèrent souvent taire le sujet plutôt que de risquer l’inconfort. Pourtant, dès leur plus jeune âge, les enfants s’interrogent spontanément sur la mort, et il est essentiel de leur apporter des réponses justes. «Quand on ne répond pas, ils imaginent souvent bien pire que la réalité», observe-t-elle.
Le silence peut avoir des effets délétères. Car au-delà de la mort elle-même ,c’est la douleur de la séparation, la peur de l’abandon qui hantent les esprits jeunes. Et lorsque cette souffrance n’est pas reconnue, elle rejaillit sur les apprentissages: perte de concentration, troubles de la mémoire, voire décrochage scolaire.
Dans ce contexte, l’école tend à privilégierdes mesures de soutien et des aménagements plutôt qu’un redoublement. Une évolution salutaire, mais encore insuffisante. Christine Fawer Caputoplaide pour une école qui soit à l’écoute des enfants qui vivent des drames. Une école qui n’élude pas la finitude, mais qui l’aborde avec respect, clarté et humanité.
Côté pratique
Christine Fawer Caputo a coordonné deux ouvrages permettant d’aborder la question de la mort avec les enfants. La Mort à l’école (De Boeck Supérieur,2015) propose des activités pédagogiques pour les 6-12 ans, tandis que la collection Les Zophes invite, dès 4 ans, à philosopher de manière ludique et ouverte sur les grandes questions existentielles, dont la mort.