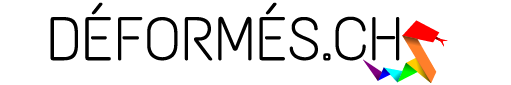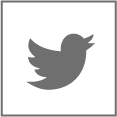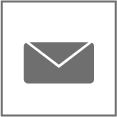Face au racisme, les Églises s’interrogent
Emeutes et heurts avec la police dans plusieurs quartiers lausannois à la suite de la mort de deux adolescents pour chassés par les forces de l’ordre. Et découverte de groupes WhatsApp aux propos discriminatoires: la question du racisme s’est invitée en force à la rentrée. Un sujet que les Églises protestantes suivent avec attention en raison de leurs standards exigeants – directement issus de leurs convictions.«L’article 157 de notre règlement ecclésiastique indique que ‹ l’Église […] s’engage en faveur de conditions de vie compatibles avec la dignité humaine […]. Elle participe aux efforts déployés pour venir à bout duracisme», souligne Matthias Siegfried, chargé de communication pour les Églises réformées de Berne-Jura-Soleure. «L’intégrité de la personne, la lutte contre les abus et le racisme ont été au coeur du code d’éthique et de conduite que nous venons de promouvoir», avance de son côté Vincent Guyaz, conseiller synodal de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV). L’Église protestante de Genève (EPG) pratique un accueil et une inclusion inconditionnels, «qui se situent de facto aux antipodes du racisme», formule pour sa part son secrétaire général,Stefan Keller.
Contexte tendu
Le contexte est tendu, les exécutifs de ces institutions en ont conscience. En janvier, la Confédération faisait état d’une hausse de 60 % de cas signalés sur la plateforme Report Online Racism. En mars, la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation constatait une hausse de 90 % des actes antisémites. Le conflit à Gaza n’est pas la seule explication.
En août, un rapport fédéral énumérait une série de lacunes en matière de prévention contre le racisme structurel, c’est-à-dire perpétué au sein des institutions… «Nous voyons les mécanismes dénoncés par ces structures, nous connaissons ces réalités et ces dangers, nous y sommes attentifs dans nos réalités de terrain», assure Vincent Guyaz, comme ses homologues. Les Églises ont pour certaines signé des déclarations, posé des actes symboliques.
Compréhension mutuelle
Sur le terrain, les réalités affrontées par les institutions protestantes sont multiples. Il y a d’une part l’accompagnement de personnes concernées par le racisme,en particulier par les aumônier·ères, par exemple les ministres chargés d’un poste «solidarité et migration», côté vaudois.«Les actions qu’ils conduisent en région impliquent des bénévoles locaux, qui, au contact de personnes migrantes, ont l’opportunité de se conscientiser quant aux discriminations, et leurs engagements ont un effet démultiplicateur: l’Église s’engage aussi par la responsabilité de chacun nourrie par l’Evangile», pointe Vincent Guyaz.
Dans nombre de leurs espaces, les Églises protestantes recherchent la mixité sociale, favorisent la compréhension mutuelle afin de désamorcer des tensions identitaires.
Mais ce rôle social fondamental peut masquer une autre réalité: un entre-soi paroissial qui manque parfois de diversité et où s’expriment, comme ailleurs, des préjugés blessants. Qu’il s’agisse de «blagues douteuses», comme le rapporte un interlocuteur, ou de «personnes qui font parfois comprendre qu’elles ont une préférence pour un accompagnement par un ministre homme et blanc», comme le constate un autre.
Un soutien sans ambiguïté
Les événements récents n’ont pas conduit les Églises à prendre de nouvelles mesures face à ce racisme «interne» aux communautés. Mais ces situations délicates sont de plus en plus abordées en institution. «Il y a un soutien très ferme et sans aucune ambiguïté envers les ministres qui, en raison de leurs origines, souffrent de discrimination», confirme un dirigeant. «A la base de nos Églises, il y a une certaine vision de l’humain», résume Matthias Siegfried. Tout en sachant que «continuer et renforcer les engagements que nous menons demande, en soi, une implication de tous les instants», pointe Stefan Keller.