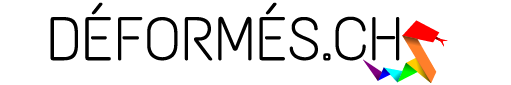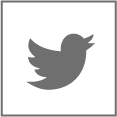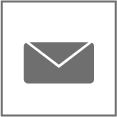Un difficile «changement de logiciel» et de posture à opérer
Les chiffres, il les connaît par coeur. «En dix ans, on a perdu 40 000 membres.» Directeur du Départementt héologie et éthique del’Église protestante de Suisse (EERS), Stephan Jütte – qui est comme nos trois autres interlocuteurs invité d’uncolloque consacré à ce sujet (lire l’encadré)– est ultra-conscient de la situation difficile de l’Église, de l’image négative que traînent l’institution et ses paroisses. «Ennuyeuse, bureaucratique, pensée pour les personnes âgées…» Il reconnaît que les Églises protestante saffrontent de sérieux défis.
La formation des pasteurs? À repenser,selon lui, pour être «plus orientée sur les compétences comme l’accompagnement spirituel, la résolutionde problèmes, que sur le savoir, les langues anciennes». Par ailleurs, «toutes les compétences ne doivent pas reposer sur le ou la pasteur•e, les communautés doivent être plus ‹ outillées».
Stephan Jütte constate aussi qu’alors que les protestants sont très actifs – actions caritatives, travail d’aumônerie, de jeunesse… –, ils sont peu doués pour le partager, donner envie. «On a une offre intéressante. On aide les gens à surmonter leurs deuils, à répondre à leurs questionnements avant un mariage, à relever des défis personnels… Mais on est incapables de rendre ce travail lisible et attractif.» Autre autocritique: l’organisation interne. «Chacune de nos 24 Églises a son logo, ses couleurs, son instance dirigeante, son community manager, son programme… C’est illisible pour le grand public.»
Une question de posture
Bruce Gordon, enseignant-chercheur à la Yale Divinity School (États-Unis) et spécialiste de la Réforme suisse, relativise.«Au XVIe siècle, les réformateurs avaient également du mal à amener les gens au culte. Calvin s’en plaignait aussi…» Cependant, il pointe une différence de posture fondamentale entre les fondateurs de l’Église réformée et les protestants d’aujourd’hui. «L’une de leurs convictions fondamentales: l’Evangile concernait tout le monde,pas uniquement ceux qui viennent au culte.» Autrement dit, le message de Dieu devait être partagé largement, «y compris aux non-croyants». Faut-il entendre cela comme un appel à redevenir missionnaire, à convertir? «D’une certaine manière, oui. Calvin concevait ses sermons comme des dialogues. Les prédicateurs de son époque savaient parler le langage de leurs contemporains,rendre l’Evangile significatif en évitant les arguments trop intellectualisés ou le‹ langage d’église ›. Nos Églises devraient renouer avec cette capacité à parler à ceux qui ne les connaissent pas. En ce sens, l’Église doit être missionnaire, non pas en essayant de forcer les gens à se convertir, mais en veillant à ce que son message atteigne la société dans son ensemble… Elle ne doit pas se contenter de se parler à elle-même!»
Communautés locales
Mais comment y parvenir, dans un monde sécularisé? Tout en continuant à répondre aux besoins de sa communauté avec toujours moins de ressources.
Juliane Schüz, pasteure et doyenne de l’arrondissement du Haut-Taunus,Église protestante de Hesse-Nassau (Allemagne),a mis en place des communautés «géolocales», sortes de regroupements de paroisses qui représentent environ 5000 personnes. Les questions financières, administratives ou foncières sont mutualisées. Et les entités de terrain organisent librement leurs activités cultuelles ou sociales. Une réforme structurelle qui permet de mieux répartir les ressources en baisse. «On peut par exemple organiser une soirée pour 50 jeunes le samedi au lieu d’en faire cinq avec dix jeunes – et on trouve des solutions créatives, comme un minibus, pour aller les chercher.» De quoi maintenir une offre existante et l’orienter vers le grand public. «Notre réseau de crèches, par exemple, est ouvert à tous.» L’Église répond donc aux besoins de ses membres et continue à s’ouvrir à la population du territoire où elle est présente. Ce qui demande un équilibre de tous les instants.
Premier "date"
«Mener ces deux orientations de front est un défi. Il faut toujours se demander: ‹ Jusqu’où veut-on être missionnaire? ›, ‹ Avec quelle posture va-t-on vers les autres? ›, ‹ Est-ce que l’on dépose un flyer avec des propositions de baptême dans notre crèche?». Les structures «géolocales» permettent, selon Jul iane Schüz, de se centrer sur ce qui doit compter aujourd’hui: le partage de croyances et les rencontres. La pasteure estime que l’époque offre une chance incroyable aux Églises. «Beaucoup de gens n’ont eu aucun contact avec le christianisme. On peut leur parler de notre histoire sans qu’ils en aient d’emblée une image négative. Je compare cela à un premier date dans des conditions idéales!»Un enthousiasme partagé par Edwin Chr. van Driel, professeur de théologie systématique et pasteur au Pittsburgh Theological Seminary (États-Unis), pour qui le rôle des Églises dans la société demande à être totalement repensé, y compris sur le plan théologique. «Dans la lettre de Paul aux Ephésiens, l’Église ou la communauté est décrite comme la manière avec laquelle Jésus réunit des personnes par ailleurs divisées sur des principes sociaux, économiques, raciaux… Jésus a le pouvoir de réunir les gens et de leur faire surmonter leurs différences. Autrement dit, si une communauté arrive à penser son existence comme étant la volonté de Jésus, cela change tout.»C’est bien un changement de référentiel auquel invite le chercheur. Plutôt que de penser son identité par rapport à d’autres acteurs sociaux, cette approche incite chaque communauté à la gratitude. «Si l’on se dit que l’on existe parce que Jésus a réussi à nous réunir, à une époque sécularisée et individualiste où être chrétien et faire partie d’une communauté est contre culture l , on prend conscience du caractère incroyable,rare, inédit que représente notre existence.» Une posture qui, pour éviter le repli, demande de passer un cap, d’accepter un renversement, Elle implique non plus d’être une communauté «dominante», «évidente»,«acceptée», mais un mouvement minoritaire, voire…méconnu, et donc ouvert à la rencontre. Un défi pour des Églises autrefois au centre de la cité. Mais une opportunité dans une époque en soif de sens et de spiritualité.
Penser l’avenir
À Zurich, un colloque inédit veut repenser le futur de l’Église réformée. Explications.
INÉDIT
32 intervenant·es de Suisse,des États-Unis et d’Allemagne, deux jours à discuter de l’avenir: la démarche portée par Elisabeth Parmentier et Christophe Chalamet (Facultéde théologie de l’Université de Genève) est pionnière.
THÉOLOGIE
L’enjeu est de réfléchir au rôle et au sens de l’Église à partir de son fondement: la théologie. Les enjeux économiques, sociaux, culturels,humains seront pris en compte.
SUISSE
Toutes les Églises chrétiennes traversent des défis similaires,mais ce sont bien les spécificités de l’Église réformée suisse qui seront au coeur des discussions. L’occasion de se replonger dans son histoire particulière… Et peut-être d’y puiser des idées et des ressources.
OUVERTURE
Impossible de dire ce qui sortira de ce colloque, mais les organisateurs se doutent qu’il s’agit surtout d’une mise en route. Beaucoup se préparent à une suite: refonder et construire le futur demande du temps.
«L’avenir de l’Église réformée enSuisse», colloque théologique multilingue, 19 au 21 octobre, Universitéde Zurich, salle RAA-G-01 Aula klein,Rämistrasse 59. Gratuit et ouvert à toute personne intéressée
Informations: www.re.fo/avenir.