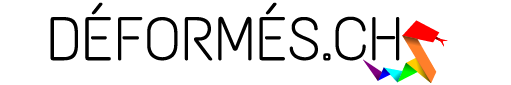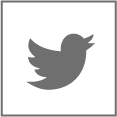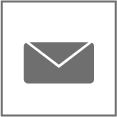Thomas Wiesel va-t-il ressusciter l’intérêt pour le culte?
Un humoriste sur la chaire d’un temple: la scène n’est pas courante. C’est pourtant le pari de la paroisse réformée de Gland, qui a invité Thomas Wiesel à sa Fête des récoltes dimanche 14 septembre. Ni spectacle ni conférence, mais un culte dominical à part entière, où l’humoriste dialoguera avec une pasteure et une diacre autour de la résurrection de Lazare.
L’idée? «Offrir une parole différente, susciter la curiosité et, pourquoi pas, attirer des fidèles qui ne franchissent plus beaucoup le seuil du temple, ou même de nouvelles personnes», comme l’explique la pasteure Chantal Rapin.
En effet, à Gland, environ une quinzaine de personnes se retrouvent actuellement chaque dimanche au culte. «Nous faisons partie des paroisses qui voient leurs effectifs diminuer, explique encore la ministre. Nous avons voulu ouvrir ce moment à d’autres, croyants ou non, pour montrer qu’il peut être porteur de profondeur, même sans adhésion à la foi.»
L’idée est née d’une discussion avec sa collègue, la diacre Christel Matthey. «Pour cette fête, nous voulions marquer le coup. L’idée de l’humoriste Thomas Wiesel, qui est très respectueux malgré son acidité, est venue. Nous avons contacté son impresario et le conseil paroissial a validé cette idée.»
Lazare revisité
Le texte choisi est l’un des plus bouleversants de l’Evangile: Lazare, mort depuis quatre jours, est rappelé à la vie par Jésus. «C’est un récit qui parle du réalisme cru de la mort et, en même temps, d’espérance, à l’image de la résurrection du Christ», souligne Chantal Rapin.» Thomas Wiesel prendra la parole pour livrer, sur ce même texte, un regard extérieur et humoristique. «Il ne s’agit pas de faire un sketch plaqué sur un culte, précise la diacre Christel Matthey, mais d’entrer dans une dynamique de dialogue: chaque intervention doit se répondre et construire ensemble une nouvelle manière de recevoir ce récit.»
Thomas Wiesel, lui, promet de ne pas se transformer en iconoclaste. «Je veux faire rire avec la matière qu’on m’a donnée, mais pas me moquer des croyants. Pour moi, c’est un signe d’ouverture d’esprit de l’Eglise de m’inviter.»
Il avoue une certaine appréhension: «Je suis habitué à des cadres variés – prévention du suicide, musique classique, justice – mais rarement drôles par essence. Ici, je ne sais pas si ça marchera. J’espère décrocher quelques rires, même si le public n’est pas venu pour se bidonner non plus.»
La liturgie, promettent les deux ministres, conservera donc ses repères essentiels afin que personne ne se sente perdu, tout en assumant une tonalité plus ludique et dialoguée. «Le pari est d’élargir l’hospitalité du culte sans en diluer le sens.», précise Christel Matthey.
Un legs pour le cachet
Un tel projet n’aurait toutefois pas été possible sans un legs ancien, destiné à la «promotion du protestantisme». «C’est grâce à ce fonds que nous avons pu nous permettre un invité de ce calibre, explique Christel Matthey. C’était la destination prévue par la personne qui a légué cette somme d’argent à notre paroisse: faire connaître notre Eglise et la rendre visible d’une manière adaptée à aujourd’hui.»
Le conseil paroissial a donc autorisé à puiser dans ce capital pour financer la venue de Thomas Wiesel. L’humoriste confirme que son cachet avoisine les 8 000 à 9 000 francs: «La paroisse a trouvé le budget pour que je sois payé presque comme ailleurs, avec un montant adapté mais pas très éloigné de ce que je demande d’ordinaire.»
Au-delà de l’aspect financier, l’investissement en temps a été considérable du côté des deux ministres: recherche de soutiens, organisation de la sonorisation et des lumières, inscriptions au repas qui suivra le culte, communication. «Nous avons dû nous lancer sur les réseaux sociaux, explique la diacre. Cela paraît simple, mais c’est en réalité un vrai travail d’inciter les gens à venir et à s’inscrire.»
Associer foi et rire reste un pari risqué. «Il y a toujours la crainte de froisser quelques paroissiens, reconnaît Christel Matthey. Mais les premiers retours positifs viennent parfois de personnes âgées. On est souvent surpris par l’ouverture de ces dernières!»
Pour Chantal Rapin, il s’agit d’«apporter de la fraîcheur, de l’espérance et de la lumière». Dans un contexte où les Eglises cherchent à se réinventer, l’humour devient ici une porte d’entrée pour «renouer avec la communauté, peut-être uniquement en suscitant au moins la curiosité!»
Du côté de l’exécutif de l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV), l’initiative est saluée. Jean-François Ramelet, membre du Conseil synodal, y voit «une très bonne chose»: «Donner la parole à des personnes extérieures à l’Eglise, qu’elles viennent du milieu culturel, scientifique, ou autre est une excellente idée. Cela permet de montrer une Eglise en lien avec le monde actuel, et pas cantonnée à sa mission spirituelle.» Mais il nuance: «Un tel événement est surtout un signe d’ouverture, mais je ne suis pas certain qu’il permette à lui seul de fidéliser de nouvelles personnes. Il rend toutefois visible une Eglise ouverte au dialogue avec d’autres univers. Et ça, c’est absolument essentiel!»
Une coutume chez les humoristes romands
Pour Joseph Gorgoni, créateur du personnage de Marie-Thérèse Porchet qui triomphe actuellement au Cirque Knie, la démarche de Gland s’inscrit dans une tradition toute helvétique: «En Suisse romande, les humoristes sont souvent invités dans des contextes sérieux. Avec mon producteur et co-auteur Pierre Naftule, nous avons développé cela dans les années 1990. Écrire un texte sur mesure pour une société, une entreprise… C’est comme écrire un spectacle pour une seule soirée.»
Lui-même avait fait visiter le Musée international de la Réforme à Genève sous les traits de Marie-Thérèse, au moment de l’ouverture de ce dernier. «À l’époque il y a eu des grincements, mais cela avait rencontré beaucoup de succès. L’humour permet de tout faire passer, si les choses sont bien faites, et surtout spécialement pour le lieu ou l’organisation qui vous engage en tant qu’humoriste.»
La Suisse, selon Thomas Wiesel, possède en effet une réelle spécificité dans ce domaine: «Depuis Gorgoni et Naftule, c’est accepté d’inviter un humoriste dans des des entreprises ou autres sociétés de gym. En France, c’est plus tabou. On a vite fait de parler, avec mépris, de “ménages”.»
Cette malléabilité du stand-up est un atout. «Sans décor ni accessoires, on peut écrire sur mesure, explique Wiesel. C’est aussi une manière de briser la routine aussi: le texte de ce culte, je ne le redirai jamais ailleurs.» Et cela lui demande du travail: «Il y a une rencontre préalable, ça se prépare très sérieusement, histoire de bien comprendre les attentes de ceux qui me sollicitent.»
La paroisse espère remplir les 200 places du temple de Gland. «Nous avons même réaménagé la galerie, indique Christel Matthey, ce qui augmente encore un peu plus la capacité du lieu.»
Thomas Wiesel, lui, prend le pari avec sérieux: «Je veux respecter ce mandat comme n’importe quel autre.» Le 14 septembre à Gland, entre Lazare et les rires, la question restera donc ouverte: faut-il faire rire, ou en tout cas lorgner sur l’extérieur de l’Eglise pour faire venir du monde au culte?